Visite du SAADIR à Ravensbrück
05.10.2025
20 | Horizons Mardi 29 avril 2025
0123
Retour à
Ravensbrück
A quelques jours de la célébration des 80 ans
de la découverte, par l’Armée rouge, du plus grand camp
pour femmes du IIIe Reich, des descendants de déportées
françaises ont effectué un voyage mémoriel sur les traces
de leurs mères, tantes ou grands-mères
Fürstenberg (Allemagne) - envoyée spéciale
Le rendez-vous a été donné à 5 h 45,
vendredi 11 avril, à l’aéroport
d’Orly. Le vol easyJet de 8 h 40 qui
doit rejoindre Berlin est en retard.
Ils sont une quarantaine à s’être
inscrits pour ce voyage en Alle-
magne, à l’initiative de la Société des familles
et amis des anciennes déportées et internées
de la Résistance (Sfaadir). Pour les 80 ans de la
découverte du camp par l’Armée rouge, le
30 avril 1945, ils tenaient à faire ce « pèleri-
nage » mémoriel à Ravensbrück, le plus
grand camp pour femmes du IIIe Reich, où
ont été déportées 8 000 Françaises dont,
pour eux, une mère, une grand-mère, une
tante. « Nous voulions le camp pour nous »,
explique la présidente de l’association, Anne
Cordier, qui a préféré un voyage « plus in-
time », loin de la foule attendue du 1er au 4 mai
pour la commémoration officielle.
L’atmosphère est enjouée mais électrique,
habitée par des sentiments mêlés, une émo-
tion contenue. C’est la septième fois qu’Anne
Cordier, 73 ans, se rend à Ravensbrück, où sa
mère, la résistante Sylvie Girard, a été dépor-
tée en 1944. Ce n’est jamais anodin. Une an-
née, elle a eu une extinction de voix pendant
toute la durée du séjour. Une autre, elle ne
pouvait plus marcher. « Cette fois, ça va…, se
persuade-t-elle. Quand il fait beau, là-bas, il y
a une énergie particulière. Et puis, la survie, la
libération, c’est le thème du voyage. »
C’est la première fois qu’aucune ancienne
déportée ne les accompagne. L’une des der-
nières survivantes, Jacqueline Fleury, 101 ans,
projetait de venir, en dépit de ses difficultés à
marcher et de sa vue déclinante. Mais quand
sa fille, Bernadette, trésorière de la Sfaadir, lui
a dit qu’elle ferait la visite en fauteuil roulant,
l’ancienne résistante, silhouette menue, re-
gard d’acier, s’est insurgée : « Ça, pas ques-
tion ! » Elle n’est pas là, mais quinze de ses des-
cendants, dont sept arrière-petits-enfants, de
10 ans à 17 ans, sont du voyage. « Je tenais à y
aller avec mes enfants tant que ma grand-
mère est encore là », explique Anne Fleury,
48 ans, qui reconnaît que ce passé est « lourd »
pour toute la famille. Elle est soulagée de faire
cette démarche au sein d’un groupe : « Nous
ne sommes pas seuls à nous emparer de son
histoire, nous la portons tous ensemble. »
A Berlin, un bus les attend pour les conduire
à Fürstenberg, à 80 kilomètres. Sous un ciel
gris, il traverse le Land de Brandebourg, où le
parti d’extrême droite, Alternative pour l’Alle-
magne (AfD), a obtenu près de 30 % des voix
aux élections régionales de septembre 2024.
« Avec le passé que nous avons, jamais je
n’aurais cru cela possible », commente la guide,
au micro. Les enfants de déportés non plus,
eux qui voient la génération de la guerre s’ef-
facer et le tragique de l’histoire revenir, dans
un triste chassé-croisé. Le bus dépasse une
usine Tesla, propriété du milliardaire Elon
Musk, qui s’est fait remarquer en janvier par
un vrai-faux salut nazi. Le soutien apporté à
l’AfD par ce proche de Donald Trump, qui en a
profité pour relativiser le passé, fait frémir
Bernard et Viviane Cauchetier.
Né cinq ans après la guerre, Bernard est le
neveu de Magdeleine Bouteloupt. Scandali-
sée par les lois antijuives de 1942, la jeune
éducatrice voit un enfant dont elle s’occupe,
à Paris, disparaître du jour au lendemain avec
sa famille. Elle intègre le réseau Comète, où
elle était chargée de convoyer les aviateurs al-
liés de Paris à Bordeaux. Un infiltré dénonce
le réseau. Elle meurt sept jours après son re-
tour de Ravensbrück, à 33 ans, à la veille de la
capitulation allemande. Les parents de Ber-
nard Cauchetier sont allés la chercher à l’Hô-
tel Lutetia, à Paris, où revenaient les déportés.
En la voyant amaigrie et épuisée, ils ont eu du
mal à la reconnaître. Avant de mourir, la ré-
sistante a dit à sa famille : « Si c’était à refaire,
je le referais. » A sa petite sœur, elle a glissé :
« Il faudra que tu me réapprennes à rire. »
Installés en Picardie, Bernard et son
épouse, Viviane, petite-fille et fille d’ouvriers
immigrés italiens ayant connu le fascisme,
s’inquiètent de voir des membres de leurs fa-
milles séduits par le discours du Rassemble-
ment national. « Il faudra parler de ce que
nous avons vu à Ravensbrück, dire que tout
peut recommencer, insiste Viviane Cauche-
tier. Nous avons un rôle à jouer. »
Sombres et monotones, les pins défilent
par la vitre. Les conversations engagées à l’aé-
roport se poursuivent. Plusieurs descendants
de déportés écrivent des livres pour que ces
vies engagées ne soient pas oubliées. Héloïse
de Menthière, 43 ans, fait des recherches sur
sa grand-tante Marie-Louise Cloarec, aide-
opératrice radio du corps féminin des trans-
missions (les « Merlinettes »), parachutée en
France depuis Londres dans la nuit du 5 au
6 avril 1944, arrêtée le 27 avril et déportée.
Réservoir de main-d’œuvre
Anne-Charlotte et Marie-Pierre Jeancard, une
avocate et une historienne, suivent les traces
de leur tante Denyse Clairouin, poétesse et
traductrice, à l’origine de la première agence
littéraire à Paris, dans les années 1930. Ayant
rejoint Mithridate, un réseau franco-britanni-
que de renseignement militaire, cette céliba-
taire charismatique est arrêtée en 1943, dé-
portée elle aussi. Aucune des deux ne ren-
trera. Marie-Louise Cloarec est fusillée à Ra-
vensbrück le 18 janvier 1945. Denyse Clairouin
meurt d’épuisement le 12 mars 1945, après
avoir été transférée à Mauthausen (Autriche).
Le bus a quitté l’autoroute. A la sortie,
aucune mention de Ravensbrück. Le camp de
femmes reste méconnu. La Sfaadir, qui se bat
contre cette « invisibilisation », a fait de nom-
breuses démarches, restées vaines, pour que
ce lieu de mémoire soit indiqué sur la route
qui relie Berlin et le nord de l’Allemagne. La
petite ville de Fürstenberg est déserte. Avec
ses maisons colorées, son château et ses for-
tifications médiévales, elle est comme sortie
d’un conte. Le camp se trouve à dix minutes à
peine, de l’autre côté du lac Schwedtsee.
Il ne reste rien du portail d’entrée, monu-
mental, qui ouvrait sur un complexe de
9 000 mètres carrés, entouré de hautes mu-
railles et de miradors. Le groupe s’installe
pour la nuit dans les anciens blocs d’héberge-
ment des gardiennes, transformés en
auberge de jeunesse. Un peu plus loin, à l’orée
de la forêt, des maisons individuelles en bois,
aux volets pastel, étaient réservées aux fa-
milles des officiers SS. En défaisant leurs vali-
ses, beaucoup pensent, glacés, au film du réa-
lisateur britannique Jonathan Glazer, La Zone
d’intérêt (2023), sur la famille du comman-
dant d’Auschwitz, Rudolf Höss, installée dans
un pavillon paisible, contre le mur du camp.
Samedi 12 avril, au matin, Thomas Kunz, un
guide allemand, attend le groupe devant l’an-
cien siège de la direction SS, la Kommandan-
tur. Entre 1939 et 1945, quelque 123 000 fem-
mes de toute l’Europe ont été retenues à Ra-
vensbrück : déportées politiques et résistan-
tes (en vertu du décret Nacht und Nebel,
« nuit et brouillard »), juives, Tziganes, Té-
moins de Jéhovah et d’autres personnes ju-
gées indésirables par le régime nazi. Parmi les
Françaises, l’ethnologue Germaine Tillion, la
nièce du général de Gaulle, Geneviève de
Gaulle-Anthonioz, la sœur de Simone Veil,
Denise Vernay, ou la communiste Marie-
Claude Vaillant-Couturier, y sont passées, le
camp ne cessant de s’étendre. « A la fin, le plus
grand chaos régnait », résume Thomas Kunz,
qui porte à l’épaule un sac arc-en-ciel, tache de
couleur incongrue dans ce paysage si sombre.
Les baraques des déportées ont été rasées
par les Russes, qui ont transformé le camp en
caserne, après l’avoir libéré, le 30 avril 1945.
Mais les anciennes laveries sont restées. Les
grands hangars où étaient installées des usi-
nes de textile aussi. Ravensbrück était avant
tout un camp de travail. Heinrich Himmler
tenait à ce gigantesque réservoir de
main-d’œuvre, à la disposition de l’industrie
allemande. L’entreprise Siemens avait installé
vingt halles de production à proximité du
camp. Anne-Charlotte Jeancard demande au
guide où se trouve la place d’appel. Dans un
poème, L’Appel, sa tante Denyse Clairouin dé-
crit le « ciel noir » et la « terre noire », les « visa-
ges de chiens errants » des déportées : « Se sou-
vient-on encore d’elles,/ Celles qui paient ar-
gent comptant/Pour que la vie soit libre et
belle/Et que la France ait un printemps ? »
Le guide conduit le groupe vers une espla-
nade immense et triste, l’Appelplatz, où les dé-
tenues, réveillées à 3 h 30, étaient comptées,
sans pouvoir bouger, affrontant les tempéra-
tures brûlantes ou glaciales de cette « petite
Sibérie ». Epuisées, elles se soutenaient discrè-
tement pour ne pas être repérées par les gar-
diennes et leurs chiens. Lors des « sélections »,
les blessées, les plus âgées, ou celles considé-
rées comme trop faibles pour travailler,
étaient isolées, puis éliminées. Dans son livre
Ravensbrück (La Baconnière, 1946), Germaine
Tillion décrit la mise en rang par cinq, avec in-
jures et coups, l’attente debout devant les bâ-
timents sombres, « le défilé de fantômes hâ-
ves, déguenillés, squelettiques » et « l’odeur de
tombeau qui les suivait ». « Cela permettait
tout de suite de savoir que (…) tout était fini,
que de cet abîme on ne ressortait pas. »
A l’entrée du camp ont été conservées les
fondations du Revier, l’infirmerie. Un mou-
roir où les SS tuaient les prisonnières par in-
jection. Plus loin, le bunker, où certaines
étaient mises à l’isolement, bastonnées, ou
servaient de cobayes aux expériences médica-
les du sinistre professeur Karl Gebhardt. Dans
La Traversée de la nuit (Seuil, 1998), Geneviève
Quelque 123 000
femmes ont été
retenues dans le
camp : déportées
politiques
et résistantes,
juives, Tziganes,
Témoins de Jéhovah V1
Sortie par de cazanove le 28/04/2025 07:46:59 Date de Publication 29/4/2025
p20 b90 p20 b90 Demain un Autre Jour: 2025-04-28T10:42:25c:Le Monde;u:spierre@mp.com.fr; 2025-04-28T11:00:29+02:00
0123
Mardi 29 avril 2025 Horizons | 21
de Gaulle-Anthonioz raconte les trois mois
qu’elle a passés dans l’un de ces cachots humi-
des, « comme si Dieu était resté à l’extérieur ».
Le soleil du printemps tranche avec la gra-
vité du moment. Frêle et concentrée, Marie-
Odile Astier-Tuloup prend des notes dans un
petit carnet. Sa mère, Andrée Bès, employée à
la préfecture de Versailles, intègre à 24 ans le
réseau Défense de la France. Avec son amie de
lycée, Jacqueline Fleury, elle transporte tracts
et faux papiers, la nuit, en passant par les cou-
loirs du métro. Arrêtée à l’été 1943, elle est
brutalement interrogée rue Lauriston par les
inspecteurs Henri Lafont et Pierre Bonny,
chefs redoutés de la Gestapo. « Tiens-toi ! Ima-
gine que tu tournes dans un film », lui intime
sa mère, arrêtée elle aussi, qui retrouve sa fille
ensanglantée dans un fourgon pour Fresnes.
le retour, une épreuve de plus
Du camp, où elle arrive le 3 février 1944,
Andrée Bès a gardé des amitiés pour la vie.
Mais, comme pour toutes les autres, le retour
a été une épreuve de plus. Marie-Odile se
souvient de ses cris, la nuit, de son obsession
du froid. Elle ne partait jamais en voyage
sans trois ou quatre paires de chaussures à la
fois. « Plus les années passaient, plus les sou-
venirs du camp revenaient, raconte sa fille. La
dernière année a été terrible. Elle ne suppor-
tait plus qu’on ferme la porte de sa chambre. »
C’est Marie Bès, sa grand-mère, qui a ra-
conté l’essentiel à Marie-Odile, enfant : « Ta
mère a beaucoup souffert. » « Je ne comprenais
pas pourquoi ma mère était si dure, pourquoi
ma grand-mère avait l’air si triste, pourquoi il y
avait cette atmosphère si bizarre à la maison »,
confie Marie-Odile Astier-Tuloup, 76 ans, qui
a longtemps œuvré pour l’Action des chré-
tiens pour l’abolition de la torture. C’est sa
troisième visite à Ravensbrück. A chaque fois,
le même rituel : elle marche seule sur la place
d’appel, en essayant d’imaginer ce que sa
mère voyait et sentait, la foule spectrale, les
odeurs et les cris, les aboiements des chiens.
« Mais je n’y arrive pas, reconnaît-elle, et je cul-
pabilise… Toute ma vie a été marquée par ça. Je
crois que je ne m’en suis jamais remise. »
La petite troupe dérive lentement vers le lac
Schwedtsee, qui borde le camp. Yves Tuloup,
le mari de Marie-Odile, se penche pour pho-
tographier une fleur qui perce sous le mâche-
fer : « Ça, c’est de la résistance. » C’est là, à l’ex-
trémité du camp, que les fours crématoires
tournaient à plein. Les habitants de Fürsten-
berg, dont le clocher et les maisons colorées
se trouvent à l’opposé, pouvaient voir les hau-
tes colonnes cracher une épaisse fumée, jour
et nuit. « Ce meurtre de masse était un secret
ouvert », souligne le guide. Début 1945, une
chambre à gaz a été installée dans le camp.
« Est-ce que le lac existe toujours ? Et les arbres
aussi ? » C’est la première chose que Béatrix de
Toulouse-Lautrec a demandée quand son fils
lui a un jour confié qu’il avait fait le voyage
pour Ravensbrück, en 1993, profitant d’une
exposition à Berlin consacrée au cousin de
son grand-père, le peintre Henri de Toulouse-
Lautrec. Membres de l’Organisation polonaise
de lutte pour l’indépendance, qui regroupait
les résistants polonais en France, Béatrix et sa
mère, Anka Sterzynska de Gontaud-Biron,
d’origine polonaise, ont fait passer des juifs en
zone libre avec des faux papiers. Arrêtées, elles
sont emprisonnées au fort Montluc et tortu-
rées « à la baignoire » par Klaus Barbie, chef
cruel et redouté de la Gestapo de Lyon. Puis
envoyées à Ravensbrück, en août 1944. Béatrix
a eu 20 ans dans le camp.
De retour en France, Anka n’a plus jamais
parlé du camp nazi. Béatrix, elle, a gardé de
nombreuses séquelles de la déportation.
Guillaume de Toulouse-Lautrec, 65 ans, se
souvient d’une mère souvent absente, alter-
nant les séjours en hôpital psychiatrique et
en maison de repos. Elle ne pouvait plus pren-
dre de bains, ni entrer dans une piscine. En
sortant du camp, elle ne voulait pas d’enfants.
Dans les années 1980, des policiers étaient ve-
nus l’interroger sur la déportation et lui pro-
poser une compensation financière, négo-
ciée avec l’Allemagne, à laquelle pouvaient
prétendre les victimes du régime nazi. Elle n’a
pas voulu signer, avançant que « l’Allemagne
n’allait pas acheter [son] courage » et que « cet
argent devait être surtout versé aux juifs,
Roms, homosexuels qui s’étaient retrouvés
dans les camps uniquement du fait de leur ap-
partenance ethnique ou sociale ». « Cela l’avait
immensément ébranlée », se souvient son fils.
Béatrix de Toulouse-Lautrec n’a jamais pu
retourner en Allemagne. Mais le premier
voyage de son fils à Ravensbrück l’a aidée à se
libérer. « Le plus grand psy, c’est toi, lui écrit-
elle au détour d’une longue lettre. Le fait que
la chair de ma chair soit revenu vivant du camp
m’aide à comprendre que la déportation fut
une expérience dans ma vie. Avant, c’était une
voie sans issue… » Guillaume, qui s’est occupé
de sa mère jusqu’à la fin, a attendu sa mort,
en 2017, à 95 ans, pour faire sa vie : se marier, à
près de 60 ans, et avoir un enfant. Il a décidé
d’offrir aux archives de Ravensbrück un plan
du camp qu’elle avait dessiné. Sur une feuille
de papier jauni, Béatrix a tracé au crayon l’em-
placement des baraques numérotées, le Re-
vier, la cantine SS, les fours crématoires et la
chambre à gaz. Guillaume est heureux que ce
document retourne d’où il vient : « Dans
vingt ans, pour le 100e anniversaire de la libéra-
tion des camps, mon fils aura 25 ans. Je ne veux
pas qu’il soit contaminé par cette histoire. »
Les voilà tous au bord du lac, que les dépor-
tées devaient parfois longer pour rejoindre
leur unité de travail. Un paysage « beau et
triste », décrivait Geneviève de Gaulle-Antho-
nioz : du sable, des pins et des bouleaux. La fa-
mille Fleury se trouve au grand complet. Ber-
nadette lit un message de sa mère : « Mes pen-
sées vous accompagnent… » Jacqueline Fleury
est restée à Versailles, dans la résidence pour
seniors dans laquelle elle a déménagé en 2023.
L’ancienne résistante, élevée en 2019 par Em-
manuel Macron au grade de grand-croix de la
Légion d’honneur, aurait pu être accueillie
aux Invalides, mais elle a préféré terminer sa
vie dans le quartier où elle réside depuis 1937.
« Kaky » – son nom de résistance – a pris la
suite de Geneviève de Gaulle-Anthonioz à la
tête de l’Association nationale des anciennes
déportées et internées de la Résistance
(ADIR), avant que la disparition de cette géné-
ration n’entraîne sa dissolution, en 2006. Elle
a aussi cofondé, en 1961, le concours national
de la Résistance et de la déportation, et n’a
cessé de témoigner dans les écoles, pendant
plus de soixante ans. Inlassablement, elle ra-
contait son histoire. La résistance, à 17 ans,
dans les réseaux Défense de la France et Mith-
ridate. La déportation, dans les wagons à bes-
tiaux. Le désespoir de retrouver sa mère dans
le camp, alors que chacune de son côté avait
secrètement espéré que l’autre y échappe.
L’ordre que celle-ci lui a aussitôt donné : « On
ne pleure jamais devant un Allemand ! »
Enfin, ces terribles « marches de la mort »,
au printemps 1945, où les ont entraînées les
SS pour fuir l’avancée de l’Armée rouge. Le
partage d’un brin d’herbe pour étancher sa
soif et survivre : « Le geste le plus héroïque qui
soit », répétait Jacqueline Fleury aux écoliers,
médusés. Le difficile retour, enfin : un ma-
riage en 1946, cinq enfants dans la foulée :
« La vie recommençait… » L’ancienne résis-
tante a souvent dit qu’elle n’était jamais vrai-
ment sortie de Ravensbrück : « Tous les jours,
je pense à mes compagnes. Et je ne pardonne-
rai jamais aux Allemands ce qu’ils ont fait su-
bir à ma mère et aux enfants du camp… »
Nés après la guerre, ses enfants ont tous été
marqués par sa force, son exigence et sa rai-
deur, une carapace de pudeur qui a pu s’ap-
parenter à une certaine froideur. Yves, l’aîné,
né en 1946, se souvient des Noël de l’ADIR où
sa mère retrouvait ses compagnes : « Quand
elles étaient ensemble, on n’existait plus. » Jac-
queline Fleury a peu parlé à ses enfants. « Il y
avait encore trop de souffrances », excuse
Yves, qui se souvient combien sa mère a eu
du mal à accepter que son frère choisisse l’al-
lemand au collège. Elle est aujourd’hui ci-
toyenne d’honneur de la ville de Weimar,
près de Buchenwald, où elle a été envoyée en
Kommando (unité de travail), et se dit pro-
fondément européenne.
« Pour maman, la vie est restée un combat,
résume Bernadette Fleury. On me dit toujours :
“Tu as une mère extraordinaire.” C’est vrai,
même si elle n’a jamais pu me prendre dans ses
bras. » A 74 ans, la fille de l’ancienne déportée
le sait désormais : « On a été meurtris indirecte-
ment, à vie. » « Les effets des traumas de guerre
peuvent impacter plusieurs générations »,
confirme Séverine Fleury, psychologue.
Avant le départ pour Berlin, Séverine est al-
lée voir sa grand-mère, avec ses enfants. L’an-
cienne déportée tempêtait contre Donald
Trump, Vladimir Poutine et la guerre au Pro-
che-Orient. Sa petite-fille « adore » ces coups
de sang : « Elle est désolée de laisser le monde tel
qu’il est. Au camp, c’est grâce à cette colère
qu’elle s’en est sortie, et à la sororité. » Ils ont
promis de venir lui raconter leur voyage, en
rentrant. « C’était bien plus difficile et choquant
que l’on imaginait, même en regardant des
films, en lisant des livres, ou grâce à nos cours
d’histoire, lui ont écrit ses arrière-petits-en-
fants. La réalité est bien plus horrible et cela
nous a bouleversés. »
Ils déposent une gerbe de roses au pied de
la sculpture monumentale de Will Lammert,
la Pietà de Ravensbrück : une femme coiffée
d’un voile, se tenant droite ; une autre à l’ago-
nie, dans ses bras. Une minute de silence.
Puis, Le Chant des marais, celui des déportés,
accompagné à la trompette par Augustin, ar-
rière-petit-fils de Jacqueline Fleury. Ce chant,
à chaque fois, fait pleurer Anne Cordier. Sa
mère, Sylvie Girard, membre de l’Organisa-
tion civile et militaire, a été arrêtée fin
juillet 1944, à 21 ans, et très durement tortu-
rée : supplice de la baignoire et nerf de bœuf.
Puis, parce qu’elle refuse de parler, elle est
écartelée. Elle se réveille dans un hôpital où
on lui remet la hanche et le bras déboîtés.
Anne Cordier n’a eu connaissance de ce dé-
tail qu’après la mort de sa mère, il y a vingt-
cinq ans. « Quand elles sont rentrées, les gens
ne voulaient pas les écouter, explique-t-elle.
Ma mère m’a dit un jour : je ne voulais pas par-
ler pour éviter de faire de la peine. »
« Je ne voulais rien savoir »
Les fantômes du passé ont hanté toute sa fa-
mille. L’aîné de Sylvie Girard était bipolaire.
Son dernier a toujours cherché à comprendre,
contactant une à une les amies de sa mère. Sa
fille Anne, elle, s’est longtemps protégée. « Je
ne voulais rien savoir », dit celle qui a finale-
ment entrepris une longue analyse. « Grandir
à côté d’une héroïne vous oblige à une certaine
tenue, dit-elle. On ne se laisse pas aller, on se
tient bien, on ne se plaint pas… » En 2022, Anne
Cordier a repris les rênes de la Sfaadir, qui vise
à maintenir vivante la mémoire des dépor-
tées, et faire connaître la contribution des
femmes dans la Résistance. « Qu’est-ce que
tout cela va devenir quand on ne sera plus là ?,
interroge-t-elle. Nous avons cette histoire dans
les tripes, mais après ? Ce seront les historiens.
J’ai peur que cela disparaisse… »
Comme les autres, Sylvie Girard a entretenu
des amitiés indéfectibles avec ses anciennes
camarades, jusqu’à la fin. Mais elle est rattra-
pée par des problèmes de santé et des épiso-
des sombres. Elle s’éteint en 1999, avec le siè-
cle, « usée et révoltée », à 75 ans. « Dès qu’elle
voyait une tragédie arriver, elle disait : on s’est
battus et voilà que ça recommence ! »
Dimanche 13 avril, le groupe se rend dans
l’ancien camp d’Uckermark, à 2 kilomètres de
Ravensbrück, une annexe du camp, à partir
de 1944, où échouaient les détenues considé-
rées comme trop faibles ou trop âgées pour
travailler. Les SS les envoyaient se « reposer » ;
elles y venaient pour mourir. Il ne reste plus
une baraque sur le site, plus une trace, rien.
Seulement les arbres de la forêt, à perte de
vue. Et des stèles qui racontent « l’extrême
violence, le travail forcé, la faim et le froid… ».
Anne Cordier attend une amie, Eva Bräu-
ning. Les deux femmes se sont rencontrées à
Ravensbrück il y a six ans. Anne pleurait de-
vant le lac. Eva aussi. « Je suis émue, mais pas
pour les mêmes raisons que vous, lui dit-elle
en allemand. Mon grand-père a été l’un des
gardiens du camp. » Les deux femmes parlent
longtemps. Née en 1964, psychologue pour
enfants à Nuremberg, Eva Bräuning n’a ja-
mais rien su du passé nazi de son grand-père.
Mais une photo de son père, à 6 ans, devant
l’école de Fürstenberg, l’a mise sur la piste. En
effectuant quelques recherches, il y a près de
dix ans, elle découvre ce que ses parents lui
avaient caché : Edmund Bräuning a été l’un
des plus hauts responsables du camp de Ra-
vensbrück, à partir de l’été 1943. Avant sa mu-
tation, cet officier nazi, décrit par Germaine
Tillion comme « massif et brutal », était l’ad-
joint de Rudolf Höss, le commandant d’Aus-
chwitz. Il s’est volatilisé à la fin de la guerre,
n’a jamais été jugé. « Je savais qu’un jour tu dé-
couvrirais la vérité », lui a lâché son père, con-
traint d’avouer.
Depuis leur rencontre, Anne prévient Eva à
chaque fois qu’elle revient à Ravensbrück. La
voilà qui arrive de Berlin, avec sa compagne,
Sonya. Les deux Allemandes se mêlent au
groupe de Français, se recueillent avec eux de-
vant les stèles. Puis Anne prend Eva par le bras
et l’entraîne sur le chemin qui fend la forêt,
bordé de pierres rouge sang. Il est l’heure de
rentrer. L’Allemande et la Française marchent
lentement vers l’entrée du mémorial, enla-
cées. Quelques pas derrière elles, Sonya, qui a
accompagné son amie tout au long de cette
quête de vérité et sait à quel point cela lui a été
difficile de l’accepter et d’en parler, sort de sa
poche son portable pour les photographier
toutes les deux, de dos. L’image est belle. Elle
range son téléphone et continue à marcher
derrière elles, en pleurant doucement. p
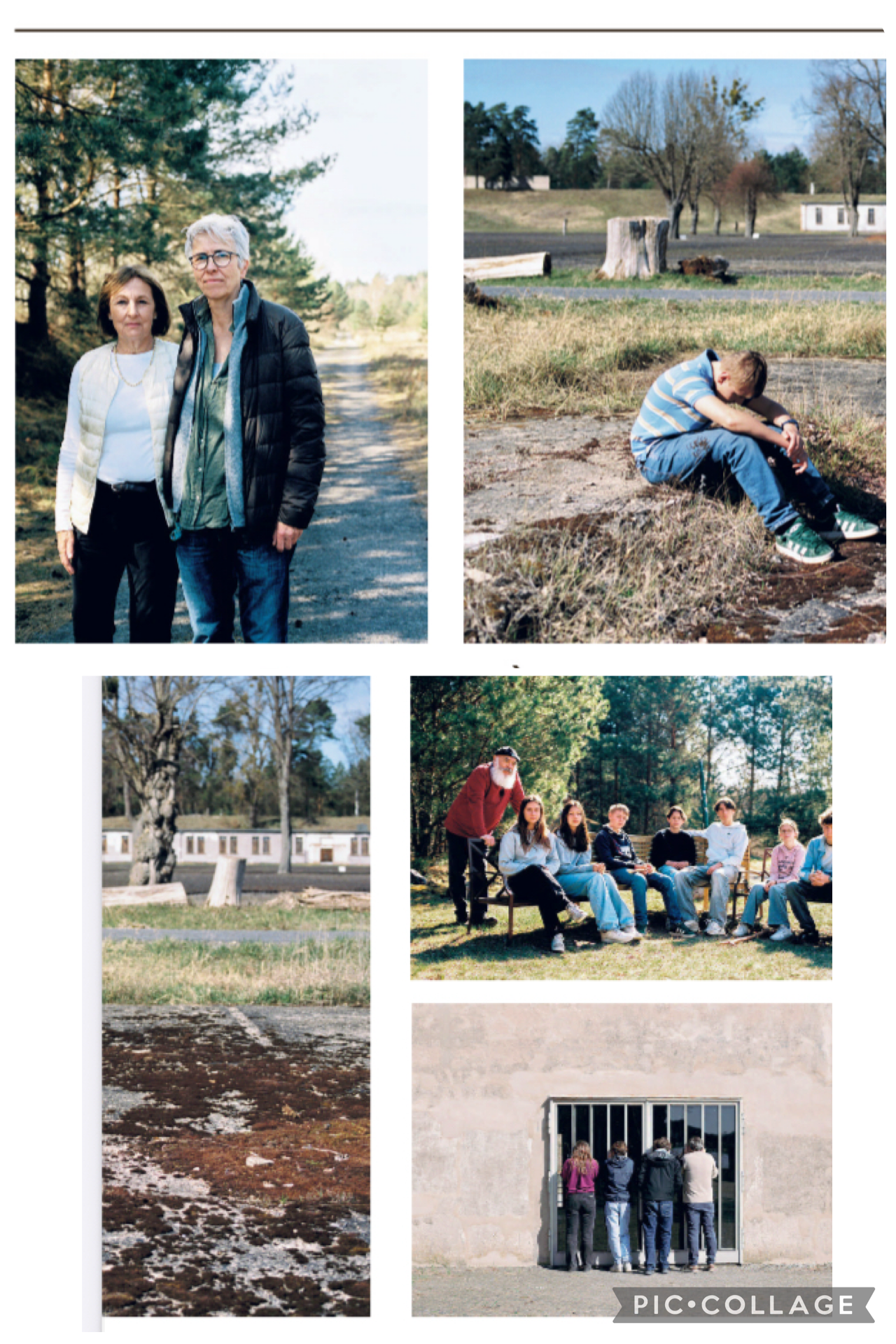
This Text is currently not availbable in your language try the other versions: